HORTENSE
Hortense avait peur. Car chaque fois que je tremblais d’effroi, mon enfant aussi. C’était obligé. Un bébé ressent tout ce qui provient de sa mère. Il faut dire qu’on aurait été effrayées à moins. Nous faisions toutes deux partie des jeunes Syriens vivant dans un squat à Saint-Denis, au nord de Paris.
Depuis le début de la guerre civile en 2011, treize millions de nos compatriotes avaient fui les bombardements du régime totalitaire. Certains s’étaient déplacés en Syrie, d’autres étaient réfugiés dans un pays voisin, en Europe ou ailleurs dans le monde. Au total, plus d’un Syrien sur deux avait été contraint de quitter son domicile. Semaine après semaine, le phénomène se répétait. Je dirais même qu’il se prolongeait, car on m’en parlait sans cesse. Un exode qui n’en finissait pas.
Derrière les carreaux sur lesquels des ruisseaux de pluie traçaient des sillons tremblotants, je pensais à Mostafa, notre oncle, qui nous avait accompagnées toutes les trois, ma sœur aînée Aïcha, le bébé et moi, durant notre immense périple.
« La France, c’est l’état des droits de l’homme, affirmait Mostafa avant de partir. Là-bas, nous serons en sécurité. »
Nous avons pris la route. Progressé à pied, en bus, en train. Nous avons traversé la Turquie. Ensuite, nous nous sommes tous entassés, de nuit, sur un bateau en partance pour la Grèce. Par bonheur, Mostafa avait des économies. Une grande partie a servi à payer le passeur. Le bateau pneumatique qui nous a transportés pouvait contenir trente personnes, mais nous avons été plus de cinquante à tenter la traversée. Ensuite, il a fallu parcourir plusieurs états avant de fouler le sol français : la Macédoine du Nord, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne.
Je berçais doucement mon bébé. Je ne voulais pas me souvenir de ces journées grises. Interminables. Épuisantes. De ces nuits chargées d’angoisse.
À Paris, nous nous sommes d’abord installés dans le campement de migrants de la Porte Saint-Ouen. Une association humanitaire nous a donné à manger, des couvertures et deux petites tentes. L’une pour Mostafa et l’autre dans laquelle il a fallu se serrer à trois. C’était le mois de mai, mais au cœur des nuits encore fraîches, j’ai grelotté.
Heureusement, au bout de quelques jours, Aïcha a lié connaissance avec Ali, un jeune Syrien de vingt ans. Il faut dire qu’avec tout juste deux années de moins, Aïcha est particulièrement jolie. Sa silhouette fine et ses grands yeux noirs ombrés de longs cils ne laissent pas les hommes indifférents. Sans compter que depuis peu, ses longs cheveux bruns voletaient librement autour d’elle.
« Ici, je ne porterai plus le voile, a-t-elle décrété. J’ai décidé de m’émanciper. » À mon tour, j’ai libéré ma chevelure dans le vent frais du matin. Mostafa n’a rien dit. Depuis notre installation dans le campement, son visage exprimait une lassitude que rien ne semblait pouvoir effacer.
Ali, qui est un garçon malin, a réussi à dénicher un appartement vide, à quelques kilomètres de là. C’est lui qui nous a proposé de venir loger dans le squat. Il s’apprêtait à y partir avec ses deux frères, Ismail et Kamel, des jumeaux de seize ans.
« Venez donc avec nous. Dans notre situation, on doit se serrer les coudes, a-t-il argumenté. » Avec Hortense dans les bras, j’ai suivi Aïcha. « Moi, je reste ici, a dit Mostafa. Le voyage m’a tellement fatigué. Et puis, avec mes douleurs, j’aurais bien du mal à monter et descendre cinq étages sans ascenseur. »
Le squat se trouvait sous le toit d’un vieil immeuble. On voyait bien qu’il était resté longtemps inoccupé. Cependant, malgré sa vétusté, il était assez grand pour les deux familles. Il possédait une salle de bains, des toilettes séparées. Par chance, l’eau n’avait pas été coupée. Une vieille cuisinière en état de marche trônait dans la cuisine. La bouteille de gaz était presque pleine.
Par contre, il n’y avait pas d’électricité et le chauffage ne fonctionnait pas. Mais personne ne s’est plaint. Avoir un toit au-dessus de sa tête, c‘était toujours mieux que la zone de stationnement de bus sur laquelle les tentes des migrants étaient montées. En bordure du périphérique. Sans eau courante.
Normalement, les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à travailler avant un délai de six mois. Mais la débrouillardise d’Ali n’était plus à prouver. Il a très vite trouvé un emploi de maçon au noir, qui amenait un salaire régulier à la maisonnée.
Quant à Ismail et Kamel, trois fois par semaine, les jours de marché à Saint-Denis, ils se rendaient utiles sous la halle. On leur donnait des invendus en fin de marché. Cela permettait de manger pendant plusieurs jours des légumes et des fruits frais. Qu’importait qu’ils soient un peu abîmés et pas du tout calibrés.
Hortense avait froid. Juillet et août avaient été torrides sous les toits, or maintenant l’automne s’installait. Les températures avaient beaucoup chuté. Dans ma maigre garde-robe, je possédais quelques vêtements. Mais Hortense n’avait rien, à part ce qu’elle portait sur le dos. Alors, comme je l’avais fait sous la tente du campement, j’ai enveloppé ma fille dans l’un de mes deux pulls. Difforme. Pelucheux. Usé d’avoir été trop souvent enfilé. Mais chaud.
J’avais confectionné un porte-bébé avec le foulard rouge de ma sœur. Chaque après-midi, Aïcha et Hortense et moi avons sillonné les rues de Saint-Denis, découvrant un quartier après l’autre. Nous avons trouvé plusieurs objets encore en bon état, abandonnés à même le trottoir : des coussins dont nous avons soigneusement lavé la housse, un joli vase à peine fêlé et une vieille guitare qu’il suffisait d’accorder. Ali connaissait un peu cet instrument. Il avait commencé à prendre des cours à Damas. Aussi, laissant ses longs doigts courir sur les cordes, a-t-il réussi à recréer de véritables mélodies. La musique était bienvenue dans le squat. Chacun chantonnait. Aïcha m’entraînait dans des danses improvisées et les jumeaux se déhanchaient comiquement, faisant fuser les rires.
Sur les conseils d’Ali, nous avons également toutes les trois pris le bus jusqu’à Pantin. Pour quelques euros, nous avons pu nous procurer de la vaisselle et de nouveaux vêtements à la boutique solidaire d’occasion Emmaüs. J’avais toujours porté une robe. Dans mon premier pantalon, j’ai sauté de joie.
Hortense avait faim. Je lui donnais le biberon. Mais parfois sa ration de lait était insuffisante. Pour moi, même si l’abondance de la nourriture laissait parfois à désirer, le pire n’était pas de cet ordre-là. Non, la plus grande faim que j’éprouvais était celle qui prenait racine dans mon cœur. Un désir inassouvi de caresses. De douceur. De mots d’amour. Aïcha et moi en manquions tant. Nos parents avaient été tués dans un bombardement, au cœur de l’indicible horreur de la guerre.
Contrairement à notre mère Mariam, Aïcha n’est pas d’un naturel démonstratif. Quant à Mostafa qui a veillé sur nous depuis la disparition de nos parents, il ne s’est jamais laissé aller à un geste de tendresse envers nous.
Peu de temps avant la disparition de ma mère, celle-ci m’a confié qu’elle aimait beaucoup ce prénom d’Hortense. Elle l’avait lu dans un livre. Tout comme le mien : Lina, qui n’est pas un prénom musulman. Alors, quand j’ai su que j’aurais une fille, j’ai décidé de la nommer ainsi. En un hommage empli d’un immense amour.
Le soir, dans le squat, nous nous éclairions à la bougie. Nous nous couchions tôt, pour ne pas user trop vite notre stock. Pourtant, autour de la table, l’ambiance était joyeuse. Nous échafaudions des tas de projets. Bientôt, la demande d’asile aboutirait et on nous prendrait en charge. Nous pourrions réaliser cette « intégration » si convoitée. Ensemble, nous bâtissions un monde meilleur. Nos yeux brillaient. Les cœurs se gonflaient d’espoir. Les langues se déliaient. C’était certain, nos futurs ne manquaient pas d’avenir. Il fallait juste faire preuve d’un peu de patience et prier Allah.
La nuit, nous dormions par terre, sur les couvertures qu’on nous avait distribuées dans le campement. C’était inconfortable et les réveils étaient fréquents. Quand nous nous levions, les dos étaient douloureux. Seule, Hortense sommeillait sans problème, lovée contre moi.
Je pleurais souvent. De grosses perles salées roulaient lentement sur mes joues ambrées. Je tentais de les dissimuler. Les essuyais très vite, d’un revers de main devenu familier. Quand l’angoisse me submergeait, je prenais mon enfant dans mes bras et le couvrais de baisers. Hortense souriait.
Ce matin-là, recroquevillée dans un coin de la pièce, je tenais mon bébé étroitement serré contre moi. Pour la première fois depuis notre traversée de l’enfer, Aïcha m’a tendu les bras.
– Allez, arrête de pleurer, Lina. Viens là.
Et sur la vieille couverture qui me servait de couche, j’ai laissé ma chère poupée Hortense, pour venir me nicher contre la poitrine rassurante d’Aïcha.
@Corinne Falbet-Desmoulin
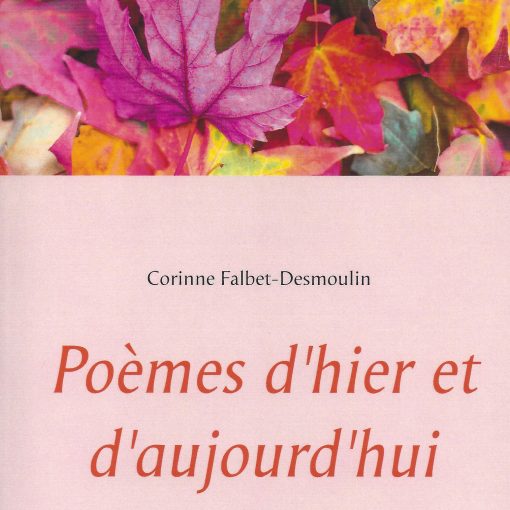



Commentaire sur “Ma dernière nouvelle à découvrir : « Hortense »”
Tu m’as eue avec ta chute ! Une très jolie nouvelle, une petite guirlande au-dessus d’une réalité sordide.